
» Bientôt, nous verrons leurs « gouttes de sang » perler sous la feuille. Dès l’Antiquité, elles étaient convoquées aux tables les plus exigeantes. Les cerises aussi ont une histoire.
Premier fruit du printemps, la cerise annonce des temps nouveaux : Annonciation et Passion du Christ dans la peinture de la Renaissance, Grand Soir pour la mémoire communarde et surtout, plus prosaïquement, arrivée appréciée des plaisirs de l’été. Le succès du « temps des cerises » tient à cet avant-goût de la belle saison au sortir de la longue période de consommation de fruits de garde.
Dès l’Antiquité, la cerise connaît les honneurs des tables les plus exigeantes. La tradition, transmise par Pline l’Ancien, veut que Lucullus, célèbre gastronome, ait rapporté le cerisier d’Asie Mineure en 73 av. J.-C. Cependant, des traces fossilisées de cerisiers, datées du Néolithique, ont été retrouvées en Europe. Et le merisier est, sous nos latitudes, une variété de cerisier indigène.
Résistant, et bien adapté au climat tempéré, le cerisier se retrouve cultivé dans les jardins et les vergers médiévaux ; des variétés sauvages, tel le griottier, y sont domestiquées. L’aristocratie se plaît alors à entretenir des cerisaies : la duchesse de Bourgogne, Marguerite de Flandre, au château de Rouvres en 1375, Charles V dans les jardins de l’hôtel parisien Saint-Pol…
Néanmoins, l’ajout attesté de sucre sur les plats de cerises proposés lors des banquets du XVe siècle, tout comme la forme des noyaux retrouvés dans le puits d’une auberge avignonnaise du XIVe siècle permettent de dresser le portrait d’un fruit très rustique, proche de l’état sauvage.

A l’époque moderne, cerises, merises et bigarreaux sont cultivés à proximité des marchés urbains. La sélection de variétés greffées sur de vigoureux merisiers permet d’étendre le fugace temps des cerises de la fin du mois de mai au début du mois de juillet. Et, autour des villes, le cerisier s’impose comme l’arbre roi des alignements arborés des routes seigneuriales et royales. Car ses fruits ont l’assurance de pouvoir remplir les hottes des marchands fruitiers.
A la fin du XVIIIe, l’avocat Calonne estime que le marché parisien recevrait en saison, de la seule vallée de Montmorency, 7 000 à 8 000 paniers de cerises par jour. En effet, chaque soir, des paysans partent pour Paris chargés de leur précieux fardeau. De retour au village, ils retrouvent d’autres paniers remplis pour la vente du lendemain. Pendant ces va-et-vient quotidiens, femmes et enfants continuent la cueillette sous la surveillance de gardes messiers2 prompts à verbaliser chahuts et maraudages.
Même si, grâce à sa primeur, son fruit ne connaît pas la dédaigneuse condescendance réservée aux banales pommes et prunes, le cerisier, lié à la spéculation marchande, n’obtient pas, dans les traités de jardinage des XVIIe et XVIIIe siècles, les honneurs décernés au poirier et au pêcher.

La cerise, massivement commercialisée, apparaît plus comme une production de marchands fruitiers et de vergers de rapport que digne d’appartenir à la société élitiste d’un jardin fruitier de curiosités. D’autant qu’elle aime à être cultivée en plein vent sur des arbres de haute tige, mais rechigne à l’espalier, ce qui lui interdit les privilèges du jardin classique.
Nonobstant, jusqu’au sein de la noblesse de cour, les cerisiers de deux terroirs parisiens jouissent d’une excellente réputation : ceux des collines de Meudon et surtout ceux de la vallée de Montmorency. Particulièrement renommée, cette cerise illustre l’amélioration de la qualité des fruits cultivés à l’époque moderne. En 1667, Jean Merlet, dans son Abrégé des bons fruits , décrit la Montmorency comme grosse, tardive, d’une eau douce, « admirable à manger » .
Cependant, victime de son succès, cette variété a été surexploitée. L’usage irraisonné de rejetons non greffés a entraîné, au cours des XVIIIe et XIXe siècles, un abâtardissement du fruit. En 1846, une commission de la Société d’horticulture du département de Seine-et-Oise constate amèrement la disparition de « cette belle variété » . Il est vrai que les descriptions du Grand Siècle ne correspondent pas à l’actuelle cerise dite « de Montmorency » : une griotte acidulée, souvent confite à l’eau-de-vie, lorsqu’elle n’est pas abandonnée au « merle moqueur » .
Loin de ces variétés acidulées, le consommateur d’aujourd’hui préfère la chair ferme et sucrée des bigarreaux. La vigueur et la productivité des bigarreautiers sont autant d’atouts aux yeux des producteurs de cerises de table.
Quels que soient les critères gustatifs et économiques, des enfants du XVIIe siècle mangeant, sur l’arbre, une poignée de guignes aux « pendants d’oreilles » de la jeune Amélie Poulain, le temps des cerises appartient à ces petits instants de bonheur dont l’histoire reste à écrire. » Florent QUELLIER ( Agrégé et docteur en histoire, Maître de conférences en histoire moderne, titulaire de la chaire CNRS histoire de l’alimentation des mondes modernes- Extrait d’un article publié dans le magazine L’Histoire)

» Le temps des cerises
En cette saison
Sur les arbres, bien touffus
De belles boules rouges
Feront des boucles aux oreilles
De générations en générations
Cela se perpétue
Près des joues, elles bougent
À leurs guises
Surtout à chaque mouvement du corps
L’odorat se réveille
Par ces fruits à bord
Les clafoutis feront de bons desserts
Attention aux noyaux sous les dents
La confiture de conservera pour l’an
Le temps des cerises est précieux comme hier
Un épouvantail éloignera les oiseaux
Ne ratez pas la marche de l’escabeau
Un accident peut se présenter
Mais, cela n’attache pas la journée
Quand la cueillette est terminée
La joie s’installe en soi
Plus qu’à faire de bons petits plats
Jusqu’à épuisement de la quantité à cuisiner. » Claudette MEPLOMD (Poétesse française)





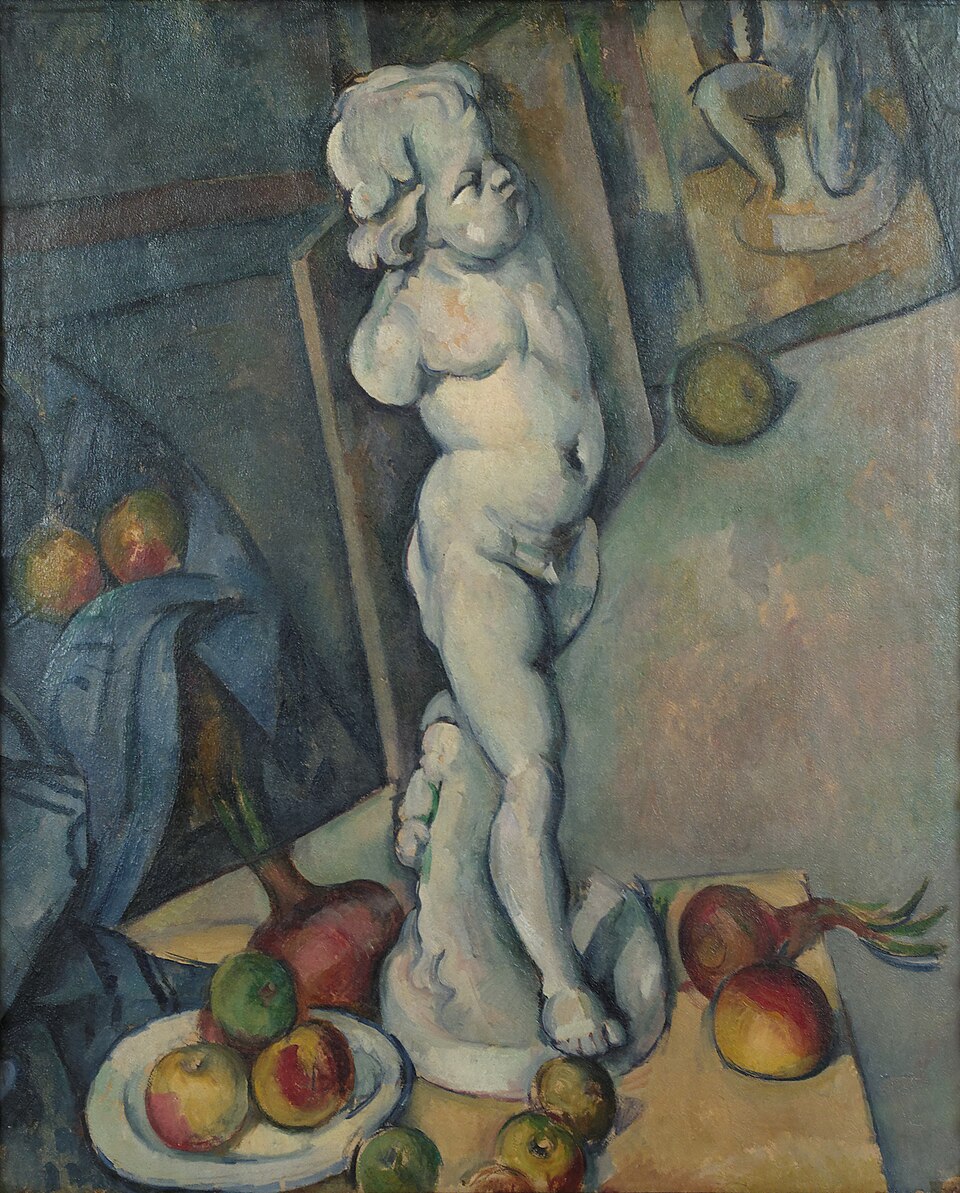

Laisser un commentaire